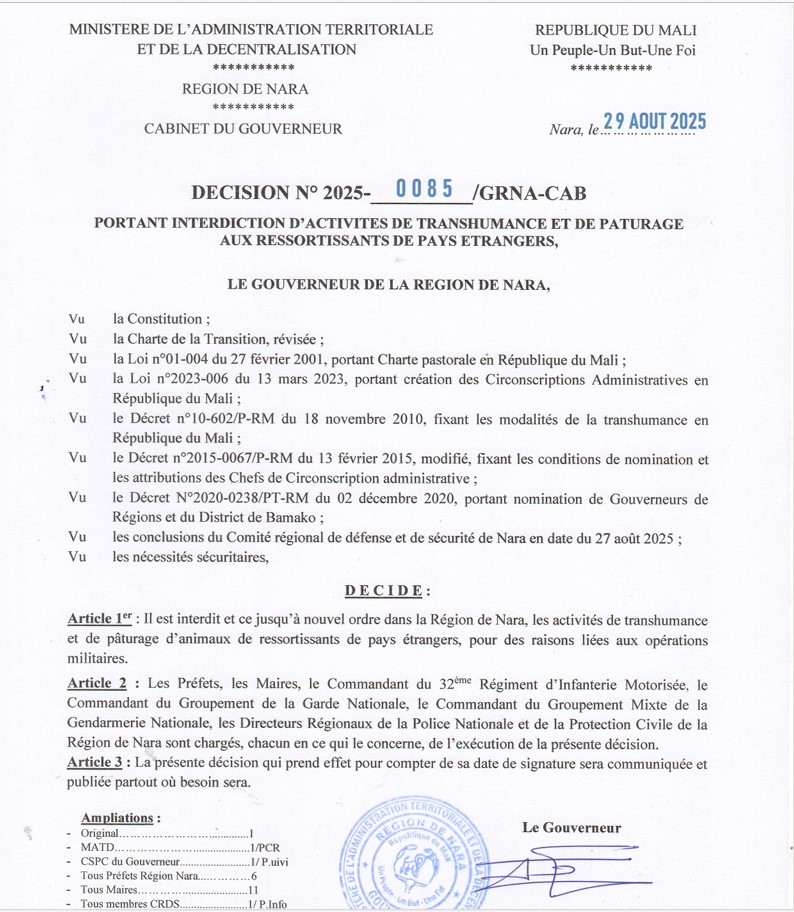
Expulsions, fermetures, interdictions : deux États se replient, deux peuples souffrent. Sous prétexte de sécurité, Bamako et Nouakchott brisent un acquis historique et piétinent la libre circulation consacrée depuis 1963. La politique des représailles, menée de part et d’autre, transforme commerçants et éleveurs en victimes collatérales d’une diplomatie aveugle.
Des fermetures ciblant la communauté mauritanienne à Bamako
Ces dernières semaines, de nombreux commerçants mauritaniens établis à Bamako ont vu leurs boutiques fermées par les autorités locales. Les raisons invoquées varient entre absence d’autorisations administratives, soupçons d’irrégularités fiscales et mesures de sécurité. Mais sur le terrain, la communauté mauritanienne dénonce un climat de harcèlement et d’incertitude qui fragilise des milliers de petits opérateurs économiques, souvent installés de longue date dans les quartiers populaires de la capitale malienne.
Ces fermetures ne sont pas anecdotiques : elles interviennent dans un contexte régional marqué par une méfiance croissante entre les deux voisins sahéliens. Beaucoup y voient une forme de représailles aux expulsions de ressortissants maliens opérées récemment en Mauritanie, où plusieurs dizaines ont été reconduits à la frontière pour séjour irrégulier ou absence de documents valides.
L’interdiction de transhumance dans la région de Nara
Un autre front de tension s’est ouvert avec la décision du Gouverneur de Nara, prise le 27 août 2025, d’interdire « jusqu’à nouvel ordre » la transhumance et le pâturage d’animaux appartenant à des ressortissants étrangers.
Officiellement, cette mesure est motivée par des « nécessités sécuritaires » liées aux opérations militaires dans cette zone frontalière sensible. Mais elle frappe en premier lieu les éleveurs mauritaniens qui, traditionnellement, déplacent chaque année leurs troupeaux vers le sud malien à la recherche de pâturages en saison sèche.
Cette interdiction bouleverse des équilibres pastoraux ancestraux et menace la survie de nombreuses familles nomades, pour qui la transhumance transfrontalière est un mode de vie autant qu’une stratégie économique vitale.
Le précédent des expulsions de Maliens de Mauritanie
Ces décisions unilatérales font écho à un autre contentieux : l’expulsion de centaines de Maliens vivant en Mauritanie dans des conditions précaires. Officiellement, Nouakchott invoque la régularisation du séjour et la lutte contre l’immigration irrégulière. Mais la multiplication des contrôles, arrestations et reconduites alimente un sentiment d’humiliation au Mali et une impression de rupture de la réciprocité entre les deux peuples.
Pour de nombreux observateurs, la fermeture des commerces mauritaniens et l’interdiction de transhumance apparaissent comme une réponse politique et symbolique à ces expulsions.
La lumière de la Convention de 1963
Or, ce climat de tensions contraste radicalement avec l’esprit de la Convention d’établissement et de circulation signée le 25 juillet 1963 entre le Mali et la Mauritanie.
Ce texte fondateur garantit aux ressortissants des deux pays :
- la liberté de circulation et d’établissement sur le territoire de l’autre partie,
- l’exercice de toutes activités économiques licites,
- ainsi que le droit de propriété et de protection juridique équivalente à celle des nationaux.
En restreignant brutalement la liberté d’entreprendre (fermeture des boutiques), la mobilité pastorale (interdiction de transhumance) et la stabilité des diasporas (expulsions), les deux États violent l’esprit et souvent la lettre de cette convention encore en vigueur.
Quand la sécurité prime sur l’intégration régionale
Les autorités des deux pays justifient leurs décisions par des considérations sécuritaires et administratives. Mais à l’échelle régionale, elles alimentent un dangereux précédent : la remise en cause d’un acquis fondamental de l’intégration ouest-africaine — la libre circulation des personnes et des biens.
Pour les commerçants et éleveurs, ce durcissement se traduit par une double peine : perte de revenus, fragilisation des réseaux transfrontaliers et accroissement de la précarité.
Pour les États, il mine la confiance mutuelle et met à mal des décennies de coopération.
Une nécessaire révision du cadre bilatéral
La situation actuelle met en évidence l’urgence d’un dialogue bilatéral rénové :
- réaffirmer la validité de la convention de 1963,
- instaurer des mécanismes conjoints de gestion des flux migratoires et pastoraux,
- et surtout protéger les populations civiles qui, loin des querelles diplomatiques, subissent de plein fouet les contrecoups de ces décisions.
Car si la souveraineté des États est indiscutable, elle ne peut se construire durablement au prix de l’exclusion des communautés qui, depuis toujours, font le lien vivant entre le Mali et la Mauritanie.
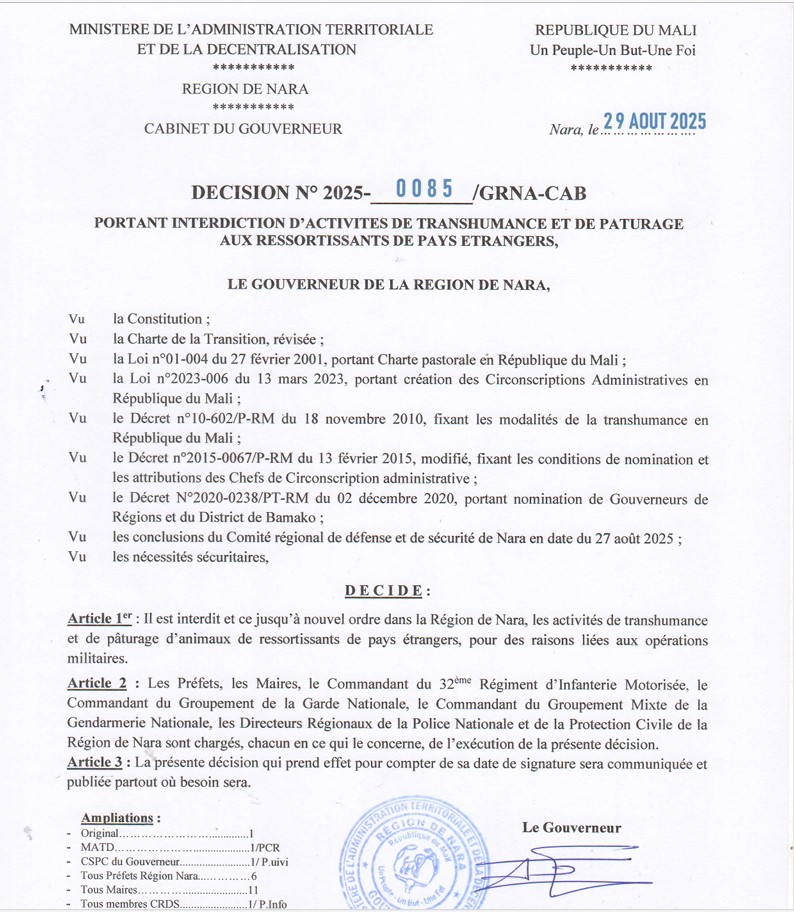

%20(1).png)


















