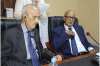Un silence lourd pèse sur les salles d'attente des urgences, tandis qu'à l'extérieur, des vies se jouent dans l'improvisation et l'ignorance. Le système de prise en charge des urgences, particulièrement pour les victimes d'accidents de la route, révèle un déficit alarmant dans nos structures sanitaires, combinant insuffisances structurelles et manque crucial de sensibilisation aux gestes qui sauvent. Cette situation dramatique transforme trop souvent des drames évitables en tragédies définitives.
L'engrenage de la défaillance dans les structures sanitaires
Dans les hôpitaux et centres de santé, le constat est implacable. Les services d'urgence sont chroniquement sous-équipés (manque de matériel de réanimation, de lits, de médicaments vitaux) et sous-staffés. Le personnel médical, souvent débordé et confronté à des flux de patients dépassant ses capacités, lutte pour prodiguer des soins adéquats dans des délais compatibles avec la survie, notamment pour les traumatismes graves.
-Délais d'intervention prolongés : L'acheminement des victimes vers des structures adaptées prend souvent trop de temps, aggravant l'état des blessés ;
-Absence de protocoles standardisés : La prise en charge initiale à l'arrivée aux urgences peut manquer de cohérence et de rapidité, faute de formation spécifique ou de ressources humaines ;
-Pénurie de spécialistes : Le manque de chirurgiens traumatologues ou neurochirurgiens disponibles 24h/24 dans de nombreuses régions est un goulet d'étranglement critique.
"On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, mais parfois, c'est comme combattre un incendie avec un verre d'eau", confie, sous couvert d'anonymat, un infirmier travaillant aux urgences d'un grand hôpital de Nouakchott.
L'impasse des premiers instants : L'ignorance qui tue
Si les structures sanitaires sont défaillantes, le maillon précédent – les premiers instants après l'accident – est tout aussi problématique, voire mortel. Un déficit flagrant de sensibilisation et de formation de la population aux gestes de premiers secours est unanimement pointé du doigt par les professionnels de santé et les observateurs.
-Inaction par méconnaissance : Face à un accidenté, la plupart des témoins ne savent pas comment réagir. La peur de mal faire, l'ignorance des gestes élémentaires (dégagement en urgence, position latérale de sécurité, compression d'une hémorragie, alerte efficace) paralysent ou conduisent à des interventions inappropriées qui peuvent aggraver les blessures ;
-Absence de réflexe "sauvetage" : Les gestes qui sauvent ne font pas partie de la culture générale ou de l'éducation de base en Mauritanie, contrairement à d'autres pays où ces formations sont plus répandues.
"Combien de vies pourraient être sauvées si les premiers témoins savaient simplement stopper une hémorragie massive ou maintenir une voie aérienne libre en attendant les secours professionnels ?", s'interroge un médecin urgentiste.
Urgence d'une culture du "geste qui sauve"
Face à ce double constat accablant – urgence médicale saturée et population non formée –, la nécessité d'agir sur deux fronts est impérative :
-Renforcer d'urgence les structures sanitaires : Investissement massif dans le matériel d'urgence, renforcement des effectifs médicaux et paramédicaux spécialisés, formation continue aux protocoles de traumatologie, amélioration de la coordination avec les services de secours (pompiers, protection civile).
-Lancer des campagnes massives de sensibilisation et de formation :
Médias de masse : Diffuser largement (TV, radio, presse) des spots et éducatifs simples sur les gestes essentiels (alerter, protéger, comprimer une hémorragie, PLS).
Formations grand public : Organiser des sessions gratuites et accessibles dans les quartiers, les écoles, les universités, les lieux de travail, en collaboration avec la Protection Civile et la Croix-Rouge mauritanienne.
Intégration scolaire : Inscrire obligatoirement les formations aux premiers secours dans les programmes scolaires, dès le plus jeune âge.
Sensibilisation ciblée : Cibler spécifiquement les chauffeurs professionnels, les forces de l'ordre et les acteurs communautaires.
Une question de vie ou de mort
Le Ministère de la Santé reconnaît "des défis à relever" dans un communiqué récent, soulignant un "plan de renforcement des urgences en cours d'élaboration" et l'existence de "modules de sensibilisation ponctuels". Cependant, l'ampleur de la crise exige une mobilisation nationale bien plus ambitieuse et concrète, avec des budgets dédiés et une volonté politique affirmée.
Chaque minute perdue entre l'accident et les soins appropriés réduit les chances de survie ou augmente le risque de séquelles graves. Combattre le déficit des urgences passe aussi, et peut-être d'abord, par former une nation de premiers sauveurs. Transformer cette impasse en une chaîne de survie efficace n'est plus une option, mais une urgence vitale pour la Mauritanie. La vie des accidentés de demain en dépend.

%20(1).png)